- | Climat ,
- Libellé inconnu,
- | Economie ,
- | Industrie ,
- | International ,
- | Santé publique ,
- | Environnement ,
Coronavirus et crise économique: le retour de l’État stratège?
Pascal Charpentier, maître de conférences en gestion au Cnam, directeur de l'Intec
Il y a quelque chose d’étrange dans la crise économique violente dans laquelle nous sommes entrés. Beaucoup l’avaient vu venir : ils étaient en effet nombreux les économistes et analystes financiers à prédire une crise en 2020, leurs supputations alarmistes ne s’étant pas réalisées en 2019, année où les records enregistrés par les marchés boursiers commençaient déjà à inquiéter.
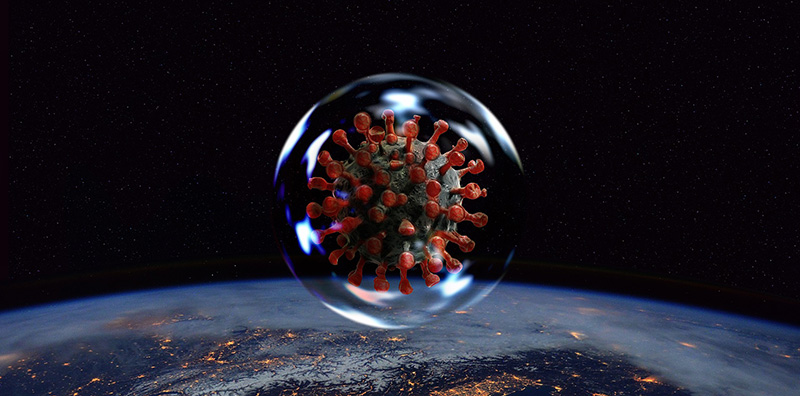
Planète Covid 19 - Pixabay
Les crises sont des phénomènes cycliques, donc on peut les anticiper surtout lorsqu’on observe qu’un écart se creuse entre le prix des actifs et leur valeur réelle, phénomène classique de bulle spéculative. Bien entendu, personne ne pouvait imaginer que le problème viendrait d’une crise sanitaire que l’on croyait d’une autre époque. Pourtant, comme les crises économiques, la pandémie actuelle n’est pas un phénomène nouveau, il y a eu d’autres exemples récents depuis une vingtaine d’années, SRAS, grippe aviaire, H1N1, ou, plus localisé, Ebola, au final moins meurtriers que les épidémies du siècle précédent, grippes espagnole, asiatique, de Hong-Kong, VIH… Les implications économiques risquent en revanche d’être sans commune mesure avec les épisodes épidémiques antérieurs. On s’interroge aujourd’hui sur l’origine de la pandémie, mais si l’hypothèse d’une origine animale, chauve-souris ou pangolin, se confirmait, la métaphore du battement d’aile du papillon dans la théorie du chaos passera pour une aimable plaisanterie. En gros, une opération d’échange sur un marché d’animaux à Wuhan mettrait à genoux l’économie mondiale, dans des proportions bien pires encore que les dérives du capitalisme financier en 2008.
À l’heure où les premiers signes d’une amélioration sanitaire se manifestent dans plusieurs pays, les débats sur le sauvetage de l’économie se multiplient. Ils sont évidemment légitimes car les États ont décidé de l’arrêt d’un grand nombre d’activités. Quel va en être le coût, comment repartir ensuite et espérer amortir le choc ? Deux autres questions y sont associées : la première concerne les cycles économiques, la crise peut-elle marquer un retournement de longue durée, et, à plus court terme, est-elle susceptible de provoquer un changement de politique économique ?
I. Les perspectives économiques sont catastrophiques. Le PIB mondial devrait reculer en 2020 d’au moins 3%.
La situation de la Chine qui représente environ un tiers de la croissance mondiale est un indicateur inquiétant, puisqu’elle a connu une baisse historique de son PIB au premier trimestre (-6,8%). Certes, elle est devenue une puissance technologique de premier plan et sa dépendance aux exportations est plus faible aujourd’hui, mais le ralentissement du commerce mondial impactera fortement ses performances dans les mois qui viennent. De plus, presque par construction, l’épidémie touche plus fortement les zones économiques les plus denses où les interactions sont les plus nombreuses. Cela explique sans doute pourquoi la Lombardie, région italienne la plus peuplée et où les échanges commerciaux sont les plus nombreux a été si durement affectée.
Même observation aux États-Unis où les zones les plus gravement atteintes sont les deux poumons du capitalisme mondialisé, New-York et la Californie. Ainsi, dans plusieurs pays, ce sont les zones les plus symboliques du capitalisme qui sont principalement concernées, jusqu’à Venise aujourd’hui déserte, ce premier centre du capitalisme naissant, ce premier espace « pré-capitaliste » pour reprendre les mots de Braudel. Et puisqu’on est dans les symboles, et même s’il s’agit d’une pure coïncidence, on fera remarquer que le pays européen le plus touché est l’Italie, seul membre du G7 à avoir intégré, en 2019, les « nouvelles routes de la soie », ce pharaonique projet chinois d’infrastructures maritimes et terrestres.
La crise pourrait bien profondément modifier les rapports de force économiques, notamment entre les deux principales puissances. Mais il faut aussi souligner l’impact qu’elle aura inévitablement sur les pays les moins avancés, ceux dont le développement dépend fortement de leur capacité à s’intégrer dans le commerce international aujourd’hui en forte contraction. Si la croissance de ces dernières années avait accru considérablement les inégalités, elle avait aussi contribué à réduire la pauvreté. On risque d’observer une forte poussée de cette dernière dans les mois et les années à venir.
En France, les premiers chiffres annoncés donnent le vertige : dépenses massives (110 milliards au minimum) pour soutenir les entreprises et les ménages, effondrement des recettes fiscales (43 milliards environ), contraction probable de 8% du PIB, déficit public à 9% de PIB, dette à 115%... Le choc est brutal, ses conséquences encore difficiles à évaluer précisément car aux tensions sur l’offre provoquées par la mise en coma artificiel de nombreux secteurs vont s’ajouter les problèmes liés au contexte sanitaire, salariés atteints, ou bloqués par la garde des enfants etc. Des filières vont être durablement sinistrées (transport, tourisme, culture, hôtellerie, commerce, automobile, immobilier…) et l’ampleur de la récession dépendra des conditions du rebond. Pour l’instant, l’État met l’économie sous perfusion d’argent public et tente de faire face aux urgences en préservant les emplois grâce au chômage partiel, par des prêts garantis pour aider les entreprises exsangues ; il envisage des recapitalisations, montées au capital voire nationalisations.
C’est ce qui avait été fait en 2008 lorsque l’État avait recapitalisé les banques pour préserver les encours de crédits aux ménages et aux entreprises et ainsi éviter ou en tout cas retarder l’impact sur l’économie réelle de la crise financière (la banque Dexia quant à elle avait été nationalisée). Il faudra sans doute aussi faire face à des tentatives de contrôle hostiles sur des entreprises dont la valorisation a fondu, les dispositifs de la loi Pacte seront mobilisés. Les dépenses envisagées vont être financées par la dette, heureusement dans un contexte de taux d’intérêt historiquement bas. Comme dans toutes les crises d’ampleur précédentes, l’urgence est de préserver le système productif, maintenir les compétences pour préparer le rebond, éviter une baisse trop importante du pouvoir d’achat des ménages qui affecterait la consommation dans les mois à venir. Mais, prévient aujourd’hui le gouverneur de la Banque de France, il faudra bien un jour rembourser l’argent emprunté…
II. L’avenir est sombre, et surtout très incertain, mais doit-on craindre d’entrer dans une grande dépression comme le monde en a connu à la fin du XIXème siècle puis après la crise de 1929 ? L’hypothèse n’est pas exclue.
D’abord parce que si le parallèle avec la crise de 1929 est pertinent, il est utile de rappeler que le PIB des États-Unis, malgré le New Deal du président Roosevelt, avait mis 10 ans (et un contexte de conflit mondial) pour retrouver son niveau d’avant-crise.
Ensuite parce que les politiques expansionnistes ont montré leurs limites lors des dernières crises. Du reste, quelles marges de manœuvre budgétaires reste-t-il pour des États qui ont profité, comme en Europe, d’assouplissements monétaires sans précédent par la mise en place de politiques non conventionnelles de quantitative easing et qui étaient déjà fortement endettés avant la survenue de la pandémie ? Les pays du sud de l’Europe sont principalement concernés, ceux du nord ayant retrouvé le chemin de la vertu. L’Allemagne a enregistré un excédent budgétaire de plus de 13 milliards d’euros en 2019, dispose d’une « cagnotte » fiscale de près de 50 milliards et a ramené son endettement au niveau exigé par les critères de convergence. Pour les pays comme l’Italie, la France, l’Espagne, il faudrait une croissance forte et un retour de l’inflation pour espérer une sortie de crise dans les années qui viennent. Cela semble néanmoins assez peu probable, les politiques particulièrement accommodantes des banques centrales n’ayant pas entraîné de poussée inflationniste ; en tout cas, personne ne peut faire un tel pari aujourd’hui dans un monde à l’arrêt.
Enfin, parce que la crise actuelle pourrait très bien constituer le point de retournement d’un cycle de longue durée. On considère généralement que le quatrième cycle de Kondratiev (cycles économiques d’une cinquantaine d’années) a commencé après la seconde guerre mondiale avec les « Trente Glorieuses », un point haut dans les années 70 au moment des crises pétrolières suivi d’une période de croissance molle et erratique marquée par une baisse de la productivité et une saturation de la demande. La reprise amorçant la phase d’expansion du cycle suivant se situerait au début des années 1990 avec la montée en puissance de la « nouvelle économie ». Le développement d’activités liées aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) ont alors permis une reprise des gains de productivité, celle que Solow dans son fameux paradoxe (on voit des ordinateurs partout sauf dans les statistiques) ne voyait toujours pas poindre en 1987. Les crises ont ensuite suivi sur un rythme quasi décennal.
En 2000-2001 avec l’éclatement de la bulle spéculative sur les activités de la nouvelle économie mais surtout l’ébranlement du système avec les faillites frauduleuses de grandes entreprises qui ont amené les États à réinterroger leurs dispositifs de sécurité financière, clé de voûte du capitalisme. Puis en 2007-2008 avec la crise des subprimes et les dérives d’un capitalisme financier mondialisé. La première a incité à une tentative de « moralisation » du capitalisme et à des réformes renforçant la sécurité financière, la seconde a incité à un peu plus de régulation… Du coup, l’apparition d’une nouvelle crise ne doit pas surprendre, elle intervient un peu plus de 10 ans après la récession mondiale de 2009. Bien sûr, on voit bien que l’élément déclencheur aujourd’hui n’est pas lié au comportement d’investissement des entreprises comme le théorisait Juglar pour ces cycles d’importance moyenne. Mais certains la voyaient venir, qui notaient aussi la faiblesse des gains de productivité et, plus grave encore, le ralentissement de l’innovation, mais sûrement pas sous cette forme et avec cette importance. On pourrait donc bien entrer dans une phase de dépression, ou au moins de récession de longue durée avec une croissance faible, jusqu’à une éventuelle reprise permise, dans une logique schumpétérienne, par des grappes d’innovations tirées par une nouvelle vision de la mondialisation, plus inclusive et plus verte…
III. Mais dans l’immédiat, il semble acquis que la crise sanitaire et ses conséquences économiques vont modifier les termes du débat politique dans notre pays.
Les deux discours récents du président de la République donnent le ton, si ce n’est de son prochain programme présidentiel, du moins de l’orientation qu’il souhaite donner aux débats post-crise.
Apparemment, le temps de la vision libérale du « ruissellement » et des « premiers de cordée » voire de la « start-up nation » serait révolu : « beaucoup de certitudes, de convictions seront balayées » (discours du 16 mars). En ligne de mire : la mondialisation débridée, l’éclatement des chaînes de valeur qui a fragmenté l’organisation productive et dont les fragilités apparaissent dans le contexte actuel. Mais le plus frappant reste la dimension gaullienne du discours. Nous ne parlons pas du ton martial ni des références à la Nation, mais bien de la vision d’une économie mieux contrôlée par l’État : « Il nous faudra rebâtir une indépendance agricole, sanitaire, industrielle et technologique française ». L’intervention du 13 avril va plus loin encore dans ce sens : « il nous faut bâtir une stratégie où nous retrouverons le temps long, la possibilité de planifier… ». Ce dernier terme est important. On a tendance à l’oublier, mais c’est bien De Gaulle qui a créé en 1946 le Commissariat Général du Plan pour orienter la politique économique du pays via des plans quinquennaux. C’était l’époque de l’interventionnisme centralisé qui bâtissait des puissances industrielles adossées à l’État, l’époque des grands programmes industriels et technologiques initiés par De Gaulle et poursuivis par Pompidou. Face aux limites avérées du capitalisme de marché où l’État libéral intervient peu s’imposerait alors une nouvelle forme de capitalisme d’État, mais d’un État qui, espérons-le, saura entre-temps se moderniser et améliorer son efficacité.
Le constat est implacable. Mais ne faisons pas mine de découvrir aujourd’hui que nous sommes tributaires de chaînes de production fractionnées et de fournisseurs parfois lointains, que nous dépendons de l’étranger pour l’approvisionnement de 70% des molécules nécessaires à la fabrication des médicaments, que notre industrie n’est pas en mesure de combler rapidement les pénuries de matériel médical ou de protection et que, tout simplement, nous ne savons pas anticiper les besoins liés aux catastrophes sanitaires. La reconquête d’une souveraineté industrielle, mais surtout sanitaire et technologique passerait alors par un retour de l’État interventionniste, orientant et planifiant. Les difficultés sont identifiées depuis longtemps et ce n’est pas faute d’y avoir réfléchi que l’on dresse ce constat alarmiste aujourd’hui. Plusieurs rapports d’experts au fond assez convergents sur les maux de l’économie française, sur sa perte de compétitivité et son déclin industriel se sont ainsi succédé : rapport Beffa de 2005, rapport Attali de 2010, rapport Gallois de 2012. Cela fait déjà bien longtemps que le rôle de l’État en matière d’orientation des politiques industrielles en France est réduit à des incitations fiscales, des aides au financement, des mesures sectorielles ou encore à l’encouragement à des pôles de compétitivité. Lorsqu’il était ministre de l’économie, Emmanuel Macron avait repris à son compte les 34 plans de reconquête industrielle proposés par Arnaud Montebourg et les avait même simplifiés en une dizaine de « solutions » de sa « nouvelle France industrielle ». On voyait s’esquisser une refonte des pôles de compétitivité, resserrés et évalués au regard de ces nouveaux objectifs. Le chantier est resté ouvert…
La mise en œuvre d’un retour de la puissance publique dans le pilotage de l’économie posera par ailleurs un double problème. Problème de faisabilité d’abord car le rattrapage dans certains secteurs économiques ou technologiques considérés comme stratégiques semble illusoire et, au mieux, ne pourra se faire, le Président l’a du reste évoqué, qu’à l’échelle de l’Europe. Problème politique ensuite, les orientations ainsi envisagées entrant en convergence avec le discours d’opposants politiques de droite comme de gauche, qui, pour des raisons différentes et selon des modalités variables plaident depuis longtemps pour le retour d’un État-Stratège. Opposants qui auront d’ailleurs beau jeu de rappeler qu’il aura bien fallu une crise sanitaire sans équivalent dans la période contemporaine pour que l’on retrouve les valeurs de « l’utilité commune » et que l’on fasse du bien-être de la population un objectif supérieur aux équilibres macro-économiques…
Les périodes de confinement se prêtent aux spéculations. On peut faire aujourd’hui sans grand risque toutes les hypothèses que l’on veut, on est au début de la crise, le retour à la normale ne sera que progressif et dans un horizon encore très incertain. On peut de la même manière les critiquer et évoquer d’autres scénarios tout aussi plausibles. Certains remarqueront à juste titre qu’échafauder des prédictions sur la base de comparaisons avec des épisodes antérieurs n’a pas forcément grand sens tant le caractère inédit de la situation est patent ; et même si la dureté du choc est semblable à celui enregistré en 1929, la situation n’est pas vraiment comparable, il n’y avait pas à l’époque d’État-providence amortisseur de crises. D’autres contesteront nos hypothèses relatives aux cycles en insistant sur le caractère en apparence exogène des origines de la crise économique actuelle… Exogène en apparence seulement sinon, cela reviendrait à nier le fait que le réchauffement climatique est bien lié à l’activité économique ; et, comme le signalent des scientifiques, sans même parler du risque des paléo-virus susceptibles de renaître d’un dégel du permafrost, le déclin de la biodiversité accélérerait l’émergence de virus dangereux.
Alors, au point où nous en sommes, nous n’hésiterons pas à faire un dernier parallèle audacieux, cette fois avec le plus grand fléau épidémique de l’histoire, la Peste Noire du début du XIVe siècle, parallèle non pas, et heureusement sur le bilan humain effroyable (on évalue la mortalité à au moins un tiers de la population de l’époque), mais dans l’origine asiatique et dans la propagation accélérée en suivant la route de la soie et des circuits commerciaux de plus en plus denses. Il y aurait même une autre similitude si on accepte l’idée de certains historiens qui pensent que la contamination avait été alors favorisée par un changement climatique. Il s’agissait alors d’une période de refroidissement : est-ce plus rassurant pour autant ?
 | Climat
Libellé inconnu
| Economie
| Industrie
| International
| Santé publique
| Environnement
| Climat
Libellé inconnu
| Economie
| Industrie
| International
| Santé publique
| Environnement
















